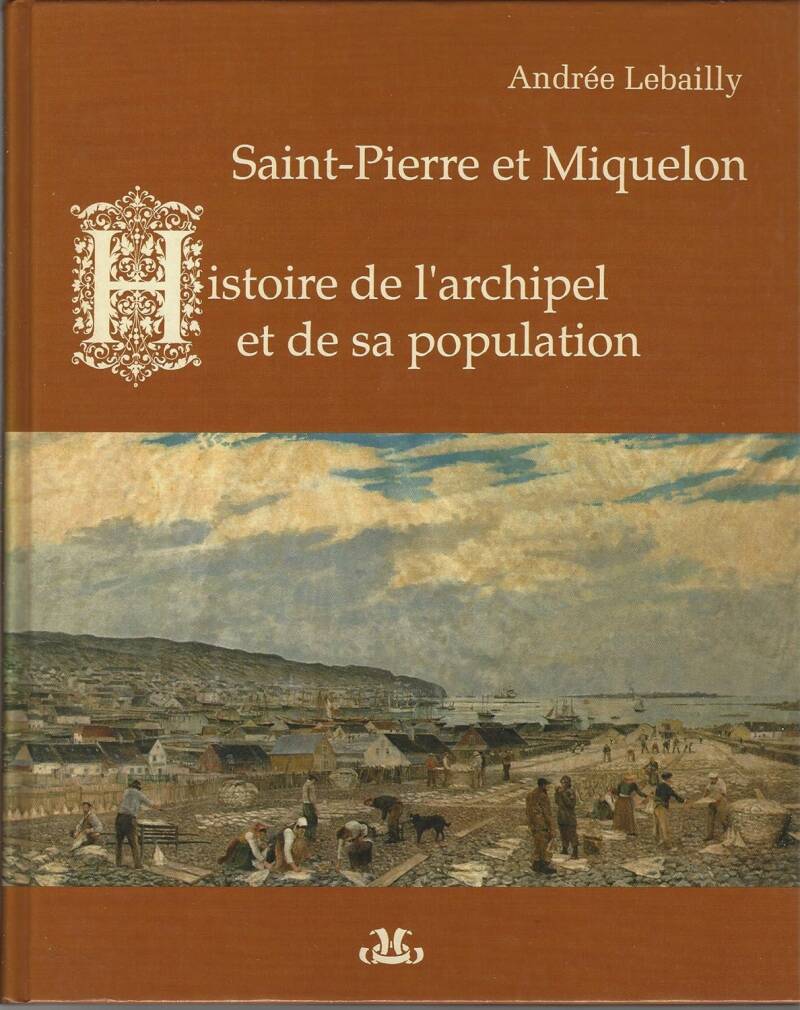Sous le souffle du vent et le fracas des vagues, Saint-Pierre et Miquelon garde dans ses toponymes et ses mots de mer l’écho d’une France maritime disparue. Des noms bretons, basques ou normands murmurent encore l’histoire des pêcheurs et des tempêtes.
Quand on arrive à Saint-Pierre par mer, la première impression est celle d’un territoire nommé avant d’être habité. Chaque pointe, chaque rocher, chaque anse porte un nom, parfois plusieurs. Ces toponymes sont comme des balises de mémoire, inscrites dans la pierre et la parole. Ils forment une carte à la fois géographique et poétique, où se lit l’histoire d’une France maritime disparue.
Le cartographe Jacques-Nicolas Bellin, chargé par la Marine royale de dresser la Carte des Isles de Saint-Pierre et Miquelon en 1755, notait déjà la profusion des noms vernaculaires : Pointe Plate, Cap Blanc, Anse à Henry, Roc à la Baleine. Ces appellations, écrites à la plume sur le vélin, étaient issues du langage des marins, non des administrateurs. Bellin lui-même l’avouait dans sa légende : « Les noms usités par les pêcheurs ont été conservés autant qu’il a été possible. »
Ainsi s’est fixée la mémoire orale d’un peuple sans monuments, dont la carte est l’équivalent d’un livre d’histoire.

L'église de" l'ile aux marins"
Photo :Marie-France derouet ( CC BY-SA 4.0)
Les mots qui baptisent l’archipel viennent de trois sources principales : le breton, le basque et le normand — les trois grandes provinces de la pêche française à Terre-Neuve.
Les Basques, présents dès le XVIᵉ siècle, ont laissé une empreinte durable. Plusieurs toponymes en dérivent :
-
Langlade, du basque Langlada (« lande plate ») ;
-
Barachois, de barratxoa (« petite barrière »), qui désigne la lagune séparée de la mer par un cordon sableux ;
-
Anse à Etcheverry ou Anse à Marticot, témoins des patronymes basques francisés.
Les Bretons ont apporté leurs propres noms descriptifs, simples et imagés : Le Gros Rocher, La Pointe-aux-Canons, Le Cap Percé. L’abbé Jean-Pierre Proulx, dans son Journal de mission à Saint-Pierre (1774-1776), évoque « ces marins du Léon et du Trégor, qui nomment les lieux comme ils nomment les vents, selon l’humeur du ciel ».
Quant aux Normands, majoritaires parmi les colons du XVIIIᵉ siècle, ils ont imposé leur accent et leur parler : L’Île aux Marins (jadis Île aux Chiens, selon la toponymie normande désignant les rochers dangereux), Anse à la Demoiselle, Pointe du Savoyard. Ces noms mêlent le pittoresque à l’utilitaire : ils servent à se repérer, à raconter, à conjurer.
Chaque langue a déposé sa strate : Saint-Pierre est un palimpseste sonore.

Panorama de St Pierre, pris du nord, photo d'André Salles (1889)
source : gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France)
De la langue du vent au français du large
Les habitants de l’archipel n’ont pas seulement nommé les lieux ; ils ont aussi nommé les vents. Avant que la météorologie ne s’impose, la rose des vents locale était un véritable lexique du climat.
-
La noroît, vent du nord-ouest, annonçait la mer froide et la brume.
-
Le suroît, vent du sud-ouest, portait la pluie et la douceur.
-
Le vent de suette — contraction de sud-est — était craint : il « fait transpirer la mer », disaient les anciens, car il rendait les eaux traîtres et les cordages humides.
-
Le vent du large était redouté pour son pouvoir de “désancrer” les esprits : superstition héritée des pêcheurs basques, selon laquelle un vent trop persistant pouvait rendre fou.
Ces termes, consignés dans le Glossaire des termes maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon établi en 1968 par l’instituteur Louis Bernabé (Archives départementales, fonds linguistique 4F), témoignent d’un savoir météorologique empirique transmis par la parole.
Les marins lisaient le ciel à travers la langue : « Quand la noroît siffle, rentre tes filets ; quand le suroît dort, reste au port », dit un vieux proverbe de Miquelon.
Jusqu’aux années 1950, le français parlé à Saint-Pierre avait un accent particulier, que les linguistes décrivent comme un français maritime atlantique. On y reconnaissait la syntaxe normande et des emprunts au basque et au breton.
L’ethnolinguiste André Martinet, lors de sa mission de 1956 pour le CNRS, notait que « les pêcheurs de Saint-Pierre conservent des mots disparus du français commun : carter (tirer un filet), chasser l’ancre (lever), gober (pêcher à la main), dégourdir un banc (repérer les poissons) ».
Les expressions reflétaient une vision du monde pratique, souvent empreinte de pudeur ou de superstition :
-
on ne disait jamais « mort » à bord, mais « absent » ;
-
un bateau qui ne rentrait pas était « passé » ;
-
les mots tempête ou naufrage étaient évités, remplacés par grosse mer ou mal de vent.
Cette langue du travail et du risque se transmettait par l’écoute. Les enfants apprenaient à parler la mer comme d’autres apprennent une prière.
Chants et contes du rivage
La culture orale de Saint-Pierre ne se limitait pas au vocabulaire technique : elle englobait chants, proverbes et récits. Les chansons de bordée rythmaient les manœuvres. On en retrouve quelques-unes dans le recueil Chansons de mer de l’Atlantique français publié en 1973 par le folkloriste Yves Defrance.
L’une d’elles, notée en 1909 par un missionnaire des Pères Eudistes, commence ainsi :
Le vent du nord mord nos mains, / la mer nous fait la leçon. / Mais Saint-Pierre nous retient, / c’est là qu’est la maison.
Les conteurs de l’île, souvent des pêcheurs à la retraite, perpétuaient aussi les récits de la mer en colère, où la vague prenait figure d’esprit ou de bête. Ces légendes, d’inspiration bretonne et basque, servaient à éduquer la prudence autant qu’à conjurer la peur.

Carte de Jacques-Nicolas Bellin(1764)
La carte comme livre d’histoire
La toponymie de l’archipel a évolué avec les époques, mais elle reste le témoin le plus fidèle de la mémoire locale. Les cartes marines anciennes montrent des dizaines de noms aujourd’hui tombés dans l’oubli : Roche des Vaisseaux, Trou des Mâts, Cap aux Rameaux, Baie des Fougères.
Ces toponymes, nés d’accidents ou de souvenirs, fonctionnaient comme une chronique du territoire : un naufrage, une tempête, une rencontre suffisaient à baptiser un lieu.
Les cartes, à Saint-Pierre, sont des cimetières de mots.

cargo-ferry arrivant à Saint-Pierre en 2005
(source : Wikipedia/CC-BY-SA-3.0)
Sauver les mots de la mer
Le tournant des années 1960 a marqué le déclin de ce monde linguistique. L’arrivée des chalutiers modernes et des ferries, la radio maritime et la scolarisation en français standard ont uniformisé le langage. Les enfants de l’archipel ont cessé d’apprendre les mots du vent pour apprendre ceux des bulletins météo.
Aujourd’hui, les linguistes recensent à peine une centaine de termes encore en usage, souvent chez les plus de soixante-dix ans. Les jeunes Saint-Pierrais comprennent rarement les mots goémonnière, suette, barachois ou noroît. Le Glossaire maritime de l’archipel est devenu un objet de curiosité, non d’usage.
Mais cette disparition n’efface pas la trace : elle la rend patrimoniale. Le Service des Archives territoriales a lancé en 2019 le projet “Mémoire des mots de mer”, visant à enregistrer les témoignages des derniers locuteurs. Ces enregistrements constituent l’un des rares corpus de français insulaire nord-atlantique conservés au monde.

Sauver les mots de la mer, c’est préserver plus qu’un lexique : c’est maintenir vivant un rapport au monde. Car ces noms disaient la prudence, la solidarité, la proximité avec les éléments. Ils traduisaient une forme d’écologie avant la lettre, où la connaissance des vents, des courants, des saisons garantissait la survie.
Aujourd’hui, les enseignants de l’archipel réintroduisent dans les classes des notions issues de ce vocabulaire : les vents, les caps, les expressions locales. L’objectif n’est pas de figer un folklore, mais de rendre aux jeunes Saint-Pierrais la conscience de ce que leur terre a inventé de singulier : une langue née du sel et du vent.
Parler mer, à Saint-Pierre, c’est parler d’un monde révolu mais toujours vivant, un monde où la parole était boussole et la mer, grammaire. Ces mots perdus sont les derniers témoins d’une civilisation du rivage — une France des ports et des goélettes, disparue du continent mais survivante, obstinée, au cœur de l’Atlantique Nord.

Chaque nom de rocher est une épitaphe, chaque nom d’anse une prière pour ceux qui ne sont jamais revenus.
Henri Daguerre
historien
Noir Lumière chante
Saint-Pierre-et-Miquelon
L'archipel en chiffres
-
Superficie : 242 km²
-
Population : environ 6 000 habitants
-
Langue : français
-
Monnaie : euro
-
Statut : collectivité d’outre-mer (COM) d
-
Capitale : Saint-Pierre
-
Activités principales : services publics, pêche artisanale, tourisme, énergies marines

L'église de Miquelon
(source : Murzabov, CC BY-SA 4.0)
A lire
Gregory Pol nous donne à voir et à aimer Saint-Pierre émergeant sous la brume et ses aussières gelées : Miquelon dont la faune se plait à inventer des fables. Ses photographies ont inspiré les textes élégants d’Alexandra Hernandez, chanteuse et poétesse, native de Saint-Pierre et Miquelon, qui se sentait en osmose avec lui

La morue fait vivre Saint-Pierre-et-Miquelon en 1887
(source J. Thouleu/gallica.bnf.fr/BnF)




photo : J&L Renard

L'hiver à Saint-Pierre
(source : Wikipedia/CC-BY-SA-3.0)

port de Saint-Pierre en hiver
(source : Wikipedia/CC-BY-SA-3.0)