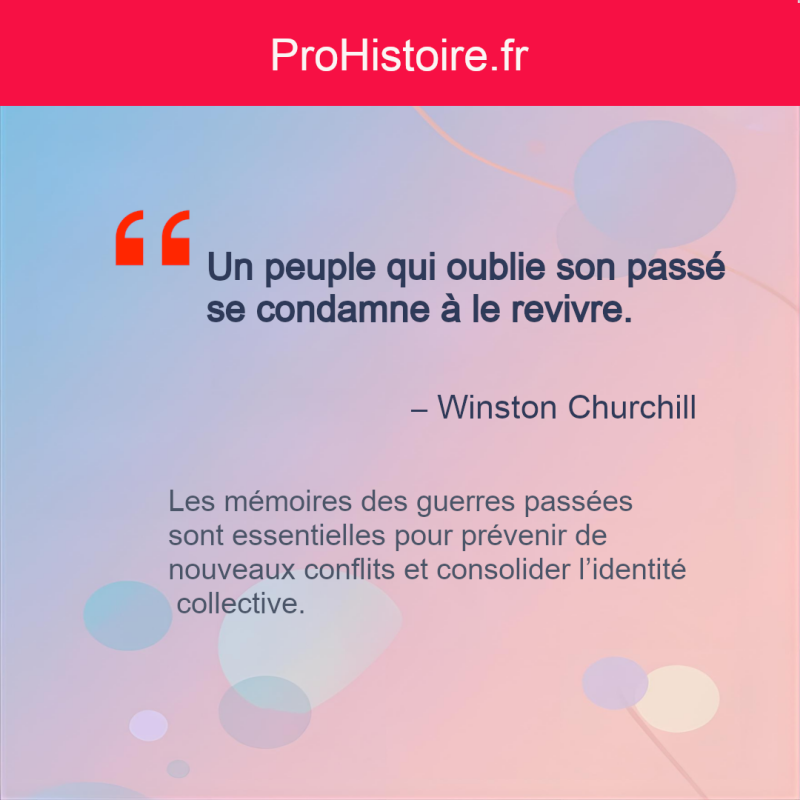Histoire et mémoires
La distinction — et le dialogue parfois conflictuel — entre mémoire et histoire constitue un enjeu central.
Comment les sociétés se souviennent-elles du passé ? Comment les historiens l’étudient-ils ? Et que se passe-t-il lorsque ces deux regards se heurtent ?

Juifs en partance pour Auschwitz,
(Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0)
Entre objectivité historique et subjectivité mémorielle
Dans les sociétés contemporaines, donner la parole aux témoins d’un événement est devenu une pratique courante. Cette démarche, qui consiste à collecter des mémoires individuelles ou collectives, permet d’enrichir le savoir historique. Mais elle n’est pas sans poser problème : si mémoire et histoire visent toutes deux à raconter le passé, elles le racontent différemment — parfois au point d’entrer en tension, voire en contradiction.
L’histoire appartient au domaine scientifique. Elle repose sur une méthode fondée sur l’analyse critique de sources variées (archives, témoignages, objets, productions culturelles). L’historien contextualise, périodise, croise les travaux de ses collègues, et cherche à reconstruire un récit aussi objectif que possible.
La mémoire, au contraire, est affective, subjective, partielle. Elle varie selon les individus, les familles, les groupes sociaux ou les nations. Il n’existe pas « une » mémoire mais des mémoires, façonnées par l’expérience personnelle, par le milieu culturel, par les représentations collectives et par les besoins du présent.
La mémoire : un objet d’histoire à part entière
Depuis les années 1980, sous l’impulsion d’historiens comme Pierre Nora, la mémoire est devenue un véritable objet de recherche. Elle permet de comprendre comment une société se raconte son passé, mais aussi pourquoi certaines périodes deviennent sensibles ou conflictuelles.
Les historiens distinguent trois grands types de mémoire :
1. La mémoire officielle
Portée par l’État, elle s’exprime à travers des politiques mémorielles : commémorations, monuments, programmes scolaires. Elle peut parfois servir un objectif politique, en valorisant un récit national unificateur.
2. La mémoire des acteurs
Celle des témoins directs, dont les souvenirs divergent souvent. Deux individus présents au même moment ne retiennent pas la même chose : la mémoire est toujours sélective.
3. La mémoire sociale
Elle correspond à la perception du passé dans l’opinion publique, mouvante selon les préoccupations du présent.
Pour comprendre ces mécanismes, le cas de la Seconde Guerre mondiale en France est éclairant. L’historien Henry Rousso identifie trois grandes phases mémorielles :
- 1945 - 1960 : Le temps de l’amnésie (perte de mémoire) : la mémoire est en quelque sorte étouffée, la société refoule les traumatismes. L’État construit un mythe politique — celui d’une France largement résistante.
-
1970 - 1990 : Le temps de l’anamnèse ( phase de remémoration collective, retour sur un passé refoulé ou oublié : les témoignages affluent, les historiens révèlent les zones d’ombre, les œuvres culturelles ravivent les mémoires.
-
Après 1990 : Le temps de l’hypermnésie ( la mémoire collective devient obsédante, voire excessive.) : multiplication des commémorations, forte demande de reconnaissance mémorielle.
Cette dynamique montre comment la mémoire évolue, s’enrichit, s’oppose parfois aux vérités établies par l’histoire.
Quand les mémoires s’affrontent
La mémoire collective peut devenir un terrain de tensions, notamment lorsque des nations portent des récits opposés d’un même événement.
Ainsi :
-
l’Occident entretient souvent une vision héroïque des croisades, tandis que dans le monde musulman elles symbolisent une agression violente ;
-
le génocide arménien est reconnu comme tel par de nombreux États, mais nié par la Turquie ;
-
les mémoires de la colonisation restent profondément divergentes entre anciens colonisateurs et colonisés.
Ces contradictions montrent que la mémoire n’est pas seulement affective : elle est aussi politique, parfois instrumentalisée pour justifier une position diplomatique, pour construire un roman national ou pour apaiser — ou raviver — des tensions internes.
Mémoire, histoire et lois mémorielles : un débat contemporain
Depuis la loi Gayssot (1990), qui pénalise le négationnisme, la France a adopté plusieurs lois mémorielles. Elles reconnaissent, par exemple, le génocide arménien, l’esclavage comme crime contre l’humanité (loi Taubira, 2001), ou les souffrances des rapatriés d’Algérie (2005).
Ces textes répondent à un besoin de justice symbolique, mais inquiètent une partie du monde académique. De nombreux historiens dénoncent un risque d’injonction mémorielle, où l’État imposerait une vision morale du passé au détriment de la liberté de recherche.
Face à cette évolution, deux mouvements apparaissent :
- Liberté pour l’histoire, fondée par Pierre Nora en 2005, s’oppose à toute loi prescrivant une interprétation historique.
- Le CVUH (Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire) adopte une position plus nuancée : il accepte le principe des lois mémorielles mais intervient pour rappeler l’état des connaissances scientifiques lorsque des polémiques surgissent.
La question est délicate : comment concilier la nécessité morale de reconnaître certains crimes et le respect de la méthode historique ?
Histoire et mémoire : un dialogue nécessaire
Si histoire et mémoire diffèrent dans leur rapport au passé, elles ne sont pas pour autant incompatibles. Bien au contraire : l’historien se nourrit des mémoires, tout en les analysant avec distance critique.
L’histoire reste un travail scientifique, jamais achevé, en constante réévaluation. La mémoire, elle, permet de comprendre comment les sociétés vivent leur passé et comment elles s’en servent pour construire leur identité.
À condition d’être interrogée, contextualisée, dépassionnée, la mémoire devient une source précieuse. Elle complète l’histoire, sans s’y substituer.
Comprendre le passé pour mieux comprendre le présent
Étudier la relation entre mémoire et histoire, c’est comprendre que le passé n’est jamais entièrement fixé. Il se redéfinit au fil des générations, des débats publics, des découvertes scientifiques.
Dans un monde où les enjeux mémoriels sont de plus en plus politisés, il est crucial de distinguer la rigueur de l’histoire de l’émotion des mémoires, sans opposer ces deux dimensions indispensables à la compréhension du monde contemporain.
Les citations "Histoire et mémoires" avec Ondes lycéennes
Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. - Winston Churchill
La mémoire s'enracine dans le concret, l'histoire s'en arrache. Pierre Nora
La mémoire est un combat.- Simone Veil
Comprendre n'est pas pardonner.- Primo Levi
Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde par le silence.- Elie Wiesel
La mémoire est un exercice de justice.- Paul Ricœur
Il existe des mémoires concurrentes qui s'affrontent pour la maîtrise du passé.- Pierre Nora
C'est arrivé, donc cela peut arriver encore.- Primo Levi
Le génocide n'a pas commencé dans les chambres à gaz, mais par des mots.- Raul Hilberg
La mémoire du mal ne doit pas devenir un instrument de haine.- Tzvetan Todorov