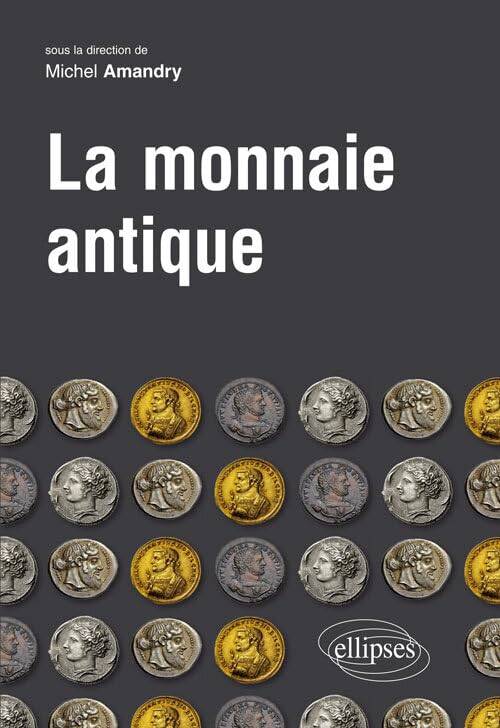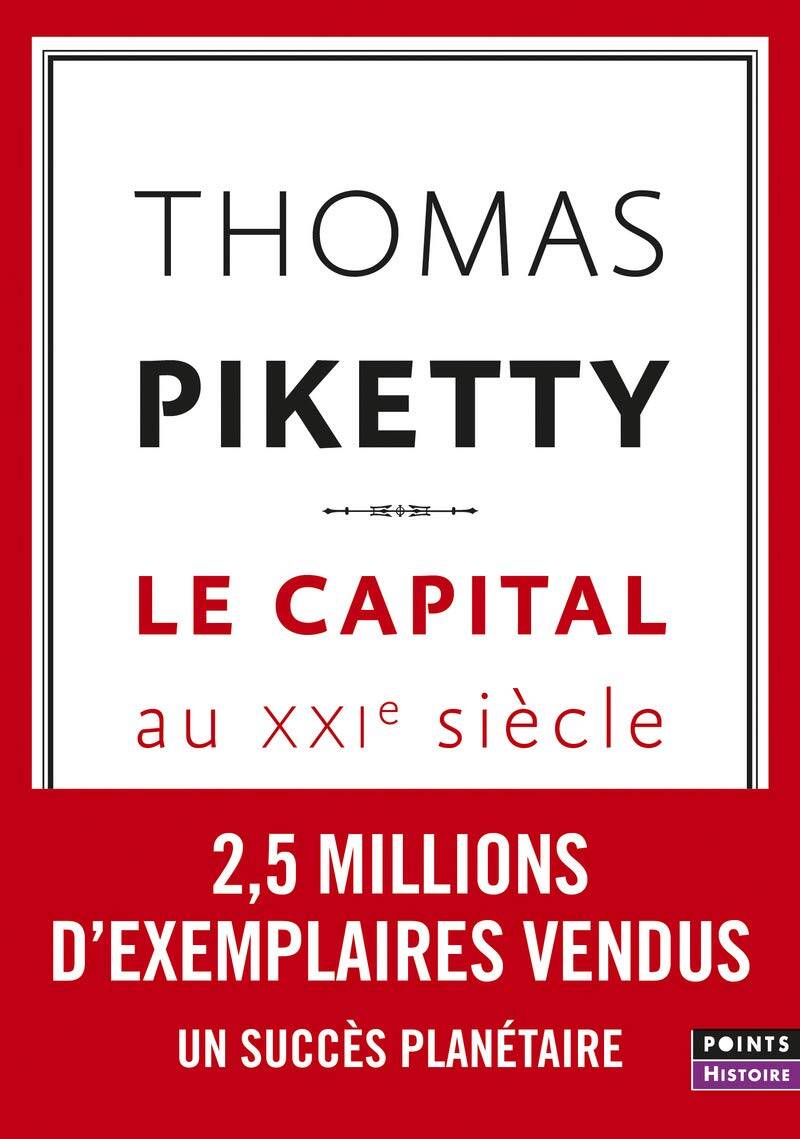Avant d’être un instrument d’échange ou de calcul, la monnaie fut d’abord un acte de souveraineté. De Crésus à la Banque centrale européenne, elle reste une question de pouvoir autant qu’un outil économique.
On croit souvent que la monnaie est née pour simplifier les échanges entre marchands. En réalité, son origine est bien plus politique que commerciale. Depuis les premières pièces frappées par les rois de Lydie jusqu’aux monnaies numériques contemporaines, la monnaie a toujours été le miroir du pouvoir : un symbole d’autorité, de confiance et de domination. Son histoire raconte celle de la manière dont les sociétés organisent — et légitiment — la valeur.


Créséides, pièces d'or et d'argent, frappées par Crésus le roi de Lydie, vers 550 avant JC
(source : Classical Numismatic Group, Inc. , CC BY-SA 3.0 )
Lorsque Crésus, roi de Lydie, au VIe siècle avant notre ère, émet les premières pièces de monnaie d'or et d'argent, toutes une même valeur intrinsèque validée, il crée le premier système monétaire bimétallique au monde. Il ne s’agissait pas d’une innovation économique au sens moderne du terme. Il ne cherchait pas à "fluidifier le marché" ni à "simplifier les échanges". Il affirmait son autorité.
Chaque pièce portait son sceau : un lion, emblème royal. Ce n’était pas seulement une garantie de valeur — c’était un acte politique. Frapper monnaie, c’était affirmer sa souveraineté sur le métal, sur le commerce, sur la société. C’était dire : " Ici, c’est moi qui décide de ce qui vaut. "
Dès lors, la monnaie devint indissociable du pouvoir. Dans la Rome antique, l’atelier monétaire du temple de Junon Moneta donna son nom à la « monnaie » elle-même. Et chaque empereur y fit graver son profil, pour rappeler à ses sujets, jusque dans la paume de leurs mains, qui régnait sur eux.

Temple de Junon Moneta, Rome
Le geste politique de la frappe n’est pas anodin : il concentre dans les mains du souverain le monopole de la valeur. Là où les sociétés sans État fonctionnaient sur des dons, contre-dons, dettes mutuelles et monnaies locales (coquillages, bétail, lingots, perles, etc.), l’apparition de la pièce marquée transforma radicalement les rapports sociaux.
La monnaie n’est pas née pour faciliter les échanges, mais pour administrer. Les souverains antiques ont utilisé la monnaie pour lever des impôts, financer des armées, payer des fonctionnaires — bref, pour rendre visible et mesurable l’obéissance.
La pièce de monnaie devint donc une technologie du contrôle. Elle permettait de centraliser la richesse, de comptabiliser les ressources, et surtout de faire circuler la confiance… non pas entre citoyens, mais entre les sujets et le pouvoir.
Quand les États créent la valeur
La monnaie n’a de valeur que parce qu’un État, un roi ou une communauté la déclare telle. C’est le principe du cours légal : vous acceptez un billet de 10 euros, non parce qu’il a une valeur intrinsèque, mais parce que l’État garantit que tout le monde devra l’accepter.
Ainsi, la monnaie repose moins sur la rareté des métaux que sur la foi politique dans l’émetteur. C’est cette confiance collective, construite et entretenue par le pouvoir, qui fonde sa valeur.
Les souverains médiévaux l’avaient bien compris. Quand Philippe le Bel fit dévaluer la monnaie au XIVe siècle pour financer ses guerres, il ne fit qu’exercer un droit royal bien connu : celui de « battre monnaie » et d’en fixer la valeur. La monnaie était — et reste — un outil de politique publique, parfois de manipulation.
Au fil des siècles, les métaux précieux ont laissé place au papier, puis à la monnaie scripturale, puis électronique. Mais le principe est demeuré : la monnaie est une promesse.
Un billet de banque n’est qu’un papier signé par l’État (ou la banque centrale) qui dit : « J’ai confiance que ce symbole sera accepté demain. » Autrement dit, la monnaie est un contrat social fondé sur la confiance institutionnelle.
Dans l’Europe moderne, la création des banques centrales (Banque d’Angleterre en 1694, Banque de France en 1800, etc.) a institutionnalisé ce pouvoir. Elles ont pris le relais des rois pour garantir la stabilité de la monnaie — mais l’esprit reste politique : la monnaie est le reflet du crédit qu’une société accorde à son propre État.
Quand la monnaie devient arme
Les crises récentes rappellent à quel point la monnaie demeure un instrument de puissance.
-
En 2008, la création massive de monnaie par les banques centrales (quantitative easing) fut un acte politique pour sauver le système financier.
-
En 2022, l’exclusion de la Russie du système SWIFT transforma la monnaie mondiale en arme géopolitique.
-
Et les cryptomonnaies, en contestant le monopole des États, réintroduisent un débat vieux de vingt-cinq siècles : qui doit décider de ce qui a de la valeur ?
Dans tous ces cas, les enjeux sont politiques avant d’être économiques. Derrière les taux, les banques et les cours de change, se cache toujours une même question : à qui fait-on confiance ?

Banque centrale européenne, Frankfort
(Norbert Nagel, CC BY-SA 3.0)
La monnaie, loin d’être une simple unité de compte, est une forme de langage collectif. Elle exprime ce que nous jugeons digne d’échange, elle mesure nos dettes réciproques, elle matérialise notre appartenance à une communauté. On ne naît pas dans une économie : on naît dans une monnaie. Et cette monnaie, qu’elle soit métallique, papier ou numérique, reste d’abord le produit d’un choix collectif.
Du roi lydien à la Banque centrale européenne, frapper monnaie, c’est décider de la valeur commune.
Autrement dit, la monnaie n’est pas née du marché, mais de l’État — et c’est ce qui en fait, encore aujourd’hui, un objet profondément politique.

La monnaie n’est pas née du troc, mais de l’autorité.
Aristote

Crésus, roi de Lydie (royaume dans l'actuelle Turquie)
portrait sur une amphoe datant de vers 490 avant JC.

Monnaies française : la bible des numismates
L'Institution monétaire de l'Humanité
La monnaie en violence et confiance
Pour Aglietta et Orléan, la monnaie n’est pas qu’un outil économique : elle fonde la confiance et le lien social. À travers l’euro ou la crise argentine, ils montrent qu’elle peut apaiser ou déclencher la violence collective. La monnaie est ainsi un « fait social total », au cœur des sociétés humaines.
Ce livre propose une introduction claire et accessible à la monnaie grecque et romaine, destinée aussi bien aux étudiants qu’au grand public curieux de comprendre l’histoire du monde. Inscrit dans la collection Le monde : une histoire, il met en lumière les apports récents de la numismatique, une discipline en plein renouvellement. Richement illustré, l’ouvrage aborde pour la première fois dans un volume français l’ensemble des monnayages dits « impériales grecques », désormais reconnus comme un élément essentiel du système monétaire romain. Loin d’être une science austère, la numismatique apparaît ici comme un outil indispensable pour éclairer l’archéologie, l’histoire, l’économie et les sociétés de l’Antiquité.
Devenu un classique dès sa parution, Le Capital au XXIᵉ siècle offre une analyse magistrale des inégalités et du capitalisme contemporain. S’appuyant sur quinze années de recherche, trois siècles d’histoire et des données issues de plus de vingt pays, Thomas Piketty renouvelle en profondeur notre compréhension de la répartition des richesses. Il met en lumière la contradiction centrale entre croissance économique et rendement du capital, montrant comment la concentration extrême des patrimoines et des hauts revenus menace aujourd’hui les idéaux de méritocratie et de justice sociale. Un ouvrage de référence pour comprendre les grands enjeux économiques et politiques de notre temps.