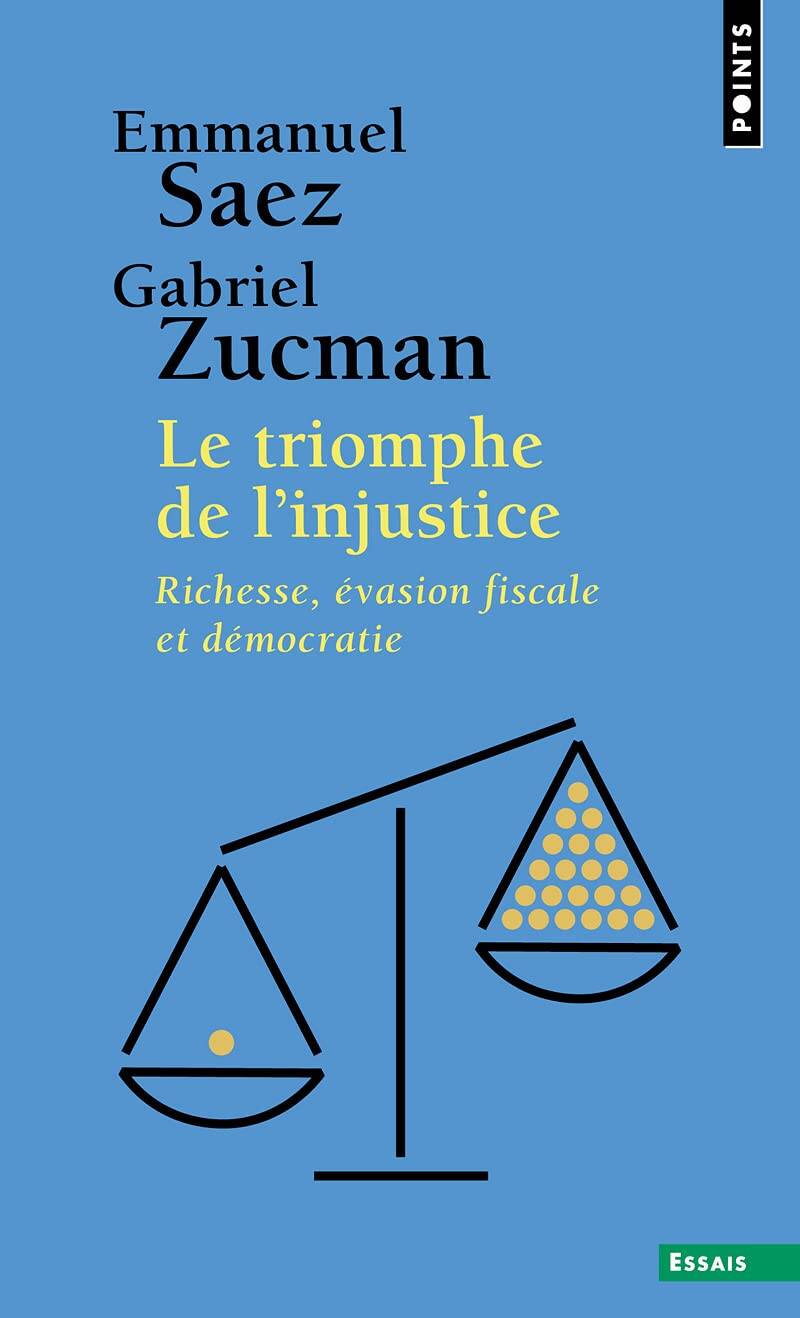Aux États-Unis, le rapport entre richesse et impôt a toujours été un miroir des tensions politiques et sociales. Tour à tour instrument de guerre, levier de redistribution ou symbole de libéralisation, la taxation des plus riches raconte un siècle de bascules idéologiques. Du sommet de 94 % sous Roosevelt à la modération actuelle de 37 %, cette histoire illustre les choix d’une nation entre solidarité et individualisme.

Signature du Social Security Act par Franklin D.Roosevelt (1935)
Avant 1913 : le pays sans impôt sur le revenu
Jusqu’au début du XXᵉ siècle, l’État fédéral américain vit principalement des droits de douane et des taxes sur la consommation. Les riches y échappent presque totalement.
Une première tentative d’instaurer un impôt sur le revenu remonte à 1861, pour financer la guerre de Sécession : 3 % sur les revenus supérieurs à 800 $ — somme considérable à l’époque. L’expérience est abandonnée dès 1872, jugée trop intrusive.
En 1894, le Congrès vote un nouvel impôt progressif, mais la Cour suprême le déclare inconstitutionnel. Il faudra attendre le 16ᵉ amendement (1913) pour permettre légalement la taxation directe des revenus. Le Revenue Act de 1913 établit alors un barème allant de 1 % à 7 % : une mesure encore très symbolique, réservée aux millionnaires.
C’est la Première Guerre mondiale qui va bouleverser la donne.
De la guerre à la justice sociale : l’explosion fiscale (1917–1960)
Bien avant que le concept moderne de « race » n’apparaisse, les sociétés anciennes ont distingué, classé, et parfois méprisé ceux qui n’étaient pas « comme eux ».
L’impôt de guerre, puis de solidarité
Pour financer son effort militaire, le gouvernement Wilson relève brutalement les taux : en 1918, le taux marginal supérieur atteint 77 %. La logique est double : mobiliser les ressources nationales et éviter les profits indécents de guerre. L’idée qu’un impôt très progressif puisse servir la nation s’impose alors durablement.
Le sommet du New Deal
Sous Franklin D. Roosevelt, la fiscalité devient un outil central du projet politique. En 1935, la Revenue Act — surnommée “Soak the Rich Tax” — renforce la progressivité du barème et taxe fortement les successions et les grandes fortunes.
Mais c’est pendant la Seconde Guerre mondiale que la fiscalité atteint son apogée historique : en 1944, le taux marginal supérieur monte à 94 % sur les revenus dépassant 200 000 $ (plusieurs millions actuels), après la guerre, il reste stabilisé à 91 % tout au long des années 1950 et jusqu’à 196
FDR défendait cette politique avec une conviction morale : « Aucun Américain ne devrait gagner plus de 25.000 $ par an après impôts pendant la guerre. » L’impôt devient un instrument d’équité démocratique.
Ces taux vertigineux ne brident pourtant pas la croissance : l’après-guerre voit s’épanouir une prospérité partagée, une classe moyenne florissante et un État social en expansion. Les économistes parleront plus tard du Great Compression, une période où les inégalités se réduisent à un niveau historiquement bas.

Source : Wikipedia/Guest2625 (CC BY-SA 3.0)
Les années 1960–1980 : la fin du consensus fiscal
La stabilité du compromis keynésien prend fin dans les années 1960. Sous Kennedy puis Johnson, les économistes conseillent de réduire les taux élevés pour stimuler l’investissement privé. Le Revenue Act of 1964 ramène le taux marginal maximal de 91 % à 70 %..
Dans les années 1980, la révolution reaganienne change radicalement de cap. Le président Ronald Reagan fait de la baisse d’impôts un pilier de sa politique : le taux supérieur tombe à 50 % dès 1982, puis à 28 % après la grande réforme de 1986 (Tax Reform Act).
C’est la naissance de l’ère du trickle-down economics, ou « théorie du ruissellement » : alléger les plus riches pour qu’ils investissent et créent des emplois. En réalité, les décennies suivantes verront surtout une explosion des inégalités et un affaiblissement relatif de la classe moyenne.
XXIᵉ siècle : la nouvelle ère des milliardaires
Des taux bas, des fortunes colossales
Depuis les années 2000, la fiscalité américaine reste modérée pour les hauts revenus : les Bush Tax Cuts (2001, 2003) abaissent les taux et allègent les successions. Barack Obama remonte partiellement le taux supérieur à 39,6 % en 2013. Donald Trump, en 2017, le redescend à 37 % et réduit massivement l’impôt sur les sociétés (de 35 % à 21 %). Résultat : le taux marginal actuel est près de trois fois inférieur à celui de l’époque Roosevelt, tandis que les inégalités reviennent à un niveau proche de celui des années 1920.
Le retour du débat
Les économistes Emmanuel Saez et Gabriel Zucman (Université de Berkeley) militent aujourd’hui pour un retour à la progressivité extrême : "Les milliardaires américains paient proportionnellement moins d’impôts que les infirmières." Leur ouvrage Le triomphe de l’injustice (2020) rappelle que l’impôt est aussi un instrument politique : il délimite ce qu’une société juge acceptable en matière d’écart de richesse.
L’administration Biden a proposé un impôt minimal sur les milliardaires et une hausse de la fiscalité du capital, sans réussir à obtenir l’accord du Congrès. Le débat reste vif : faut-il renouer avec une fiscalité de solidarité, ou préserver la compétitivité d’une économie globalisée ?
Une leçon de démocratie fiscale
L’histoire américaine de l’impôt sur les riches raconte moins une suite de chiffres qu’un combat culturel.
À travers un siècle de réformes, trois grandes visions s’affrontent :
-
L’impôt de guerre, conçu comme un devoir patriotique.
-
L’impôt social, garant de la cohésion démocratique.
-
L’impôt-incitation, pilier du libéralisme économique moderne.
Chaque cycle de hausse ou de baisse reflète une crise morale : que doit la richesse privée au bien commun ?
Roosevelt y voyait une obligation morale ; Reagan, un frein à la liberté. Entre les deux, c’est la démocratie elle-même qui se négocie.
Un écho contemporain : le débat français sur la justice fiscale
L’histoire américaine résonne étrangement avec les débats français contemporains.
De part et d’autre de l’Atlantique, la question n’est plus tant de savoir combien taxer, mais pour quoi faire.
En France, les discussions autour d’un « impôt sur les superprofits », d’une contribution exceptionnelle des milliardaires ou encore de la progressivité de l’impôt sur le revenu rappellent les grandes heures du New Deal.
Comme aux États-Unis dans les années 1930, le cœur du débat porte sur la légitimité démocratique de la richesse : jusqu’où l’inégalité reste-t-elle compatible avec la cohésion nationale ?
Le souvenir des 94 % de Roosevelt n’est pas un simple chiffre du passé : il rappelle qu’en temps de crise, la fiscalité peut redevenir un instrument de solidarité collective, et non seulement un outil de gestion budgétaire.

Le conseil des Ministres s’est réuni ce matin
Dessin de Rudder, Louis Henri de Rudder (1831)

«Dans ce monde rien n’est certain, sauf la mort et les impôts.
Benjamin Franklin
lettre à Jean-Baptiste Le Roy, 1789

« On taxe tout, hormis l'air que nous respirons » assurait la marquise du Deffand. Dans ce livre inédit en son genre, Éric Anceau et Jean-Luc Bordron racontent l'histoire universelle et millénaire de l'impôt, de l'Égypte pharaonique aux paradis fiscaux contemporains en passant par la Chine impériale, la France de Louis XIV et l'Amérique de la prohibition. En mêlant récit grandiose et anecdotes savoureuses, les auteurs parviennent à dessiner une fresque aussi passionnante que divertissante d'un sujet omniprésent. Sait-on, par exemple, que pour occidentaliser la Russie, Pierre le Grand voulait contraindre ses sujets à ne plus porter de barbes en créant un impôt sur la pilosité ? Sait-on, encore, que les guinguettes se trouvaient aux abords des villes pour échapper à la taxation ? Plus surprenant enfin, sait-on que les membres du groupe ABBA portaient des tenues excentriques parce qu'une loi suédoise permettait une réduction d'impôts sur les vêtements à condition de ne pas pouvoir les porter dans la vie de tous les jours ? Ni manuel fiscal ni guide du contribuable, cet ouvrage explique par une approche claire et plaisante l'impôt, pourquoi il existe, pourquoi on y résiste, et dessine une nouvelle histoire de la construction de l'État.
Un best-seller mondial qui est déjà devenu un classique. Parcourant trois siècles et plus de vingt pays, cette étude renouvelle entièrement notre compréhension de la dynamique du capitalisme en situant sa contradiction fondamentale dans le rapport entre la croissance économique et le rendement du capital.
Pour la première fois depuis plus d’un siècle, les milliardaires américains paient moins d’impôts, en proportion de leurs revenus, que chacun des autres groupes sociaux. Mêlant récit historique et étude économique, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman analysent les choix (et non-choix) qui ont conduit au creusement des inégalités et au triomphe de l’injustice fiscale, allant de l’exonération progressive des revenus du capital au développement d’une nouvelle industrie de l’évasion fiscale, en passant par l’engrenage de la concurrence fiscale internationale.
Ce guide à jour des dernières réformes en matière d'imposition... et d'avantages fiscaux vous donne des solutions simples et efficaces pour réduire vos impôts