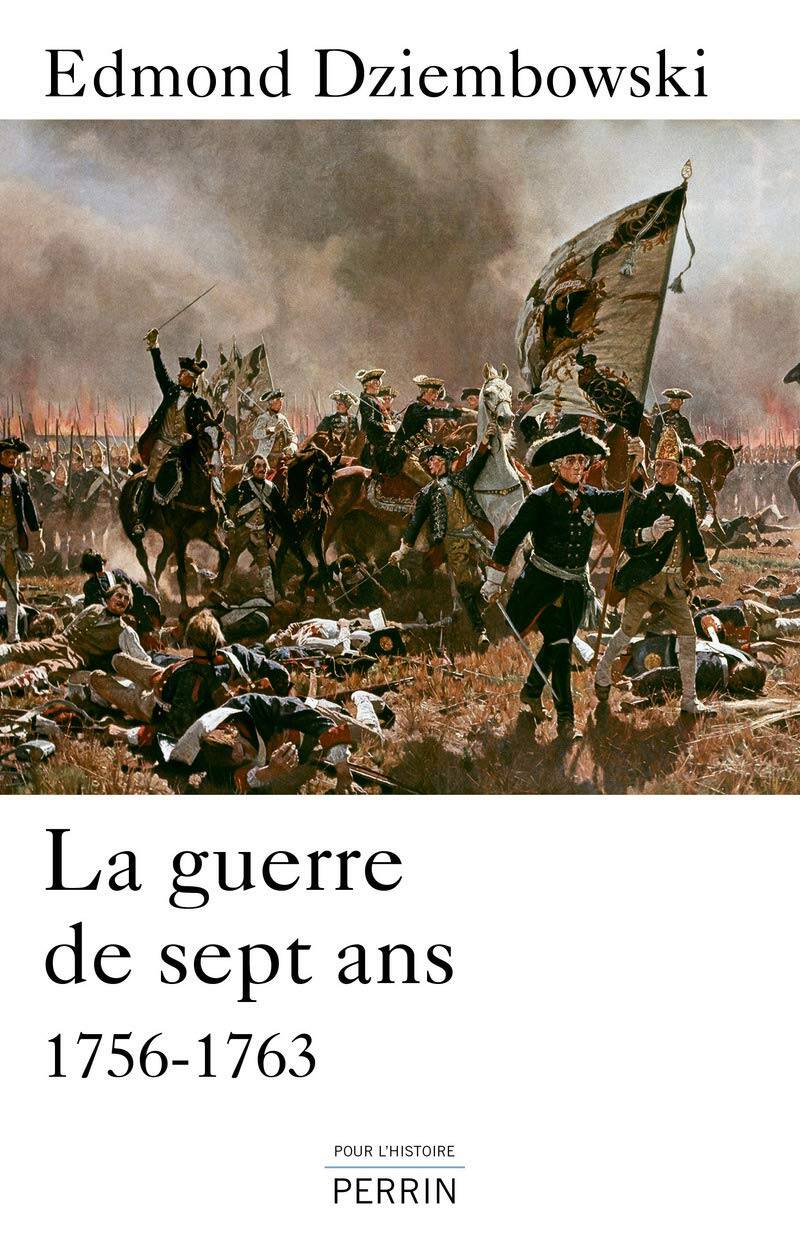Faire la guerre, faire la paix :
Les guerres contemporaines sont-elles si différentes des guerres du XVIIIe siècle ?
Des batailles rangées du XVIIIᵉ siècle aux guerres asymétriques du XXIᵉ siècle, l’art de faire la guerre a changé d’échelle et de visage. Mais derrière les innovations technologiques et idéologiques, retrouve-t-on encore les mêmes logiques de puissance ?
Au premier regard, les conflits d’aujourd’hui semblent appartenir à un tout autre monde que ceux qui ensanglantaient l’Europe des Lumières. D’un côté, des armées royales de quelques dizaines de milliers d’hommes, des batailles rangées et des traités qui rétablissent la paix. De l’autre, un XXIe siècle marqué par le terrorisme global, les guerres asymétriques et la menace nucléaire. Pourtant, l’histoire militaire n’est pas faite de ruptures brutales : elle est traversée par des continuités et des mutations progressives.

Gueldre, capitale du Duché de Gueldre, bombardé par les troupes du roi de Prusse en 1703
La guerre au XVIIIe siècle : des règles et des États
Au siècle des Lumières, la guerre reste d’abord une affaire de princes et de rois. Les armées sont composées d’officiers nobles, secondés par des mercenaires et, à partir de Louis XIV, par des milices tirées au sort. Le soldat est avant tout un professionnel, et non un citoyen.
Les guerres obéissent alors à un certain formalisme : une déclaration officielle ouvre les hostilités, une capitulation ou un traité les referme. Le but n’est pas l’anéantissement de l’adversaire, mais sa mise à genoux pour négocier. L’exemple des guerres de succession (Autriche, Espagne) illustre bien ces logiques : il s’agit de contrôler un territoire, d’empêcher un voisin de devenir trop puissant, non de détruire une nation entière.
La guerre de Sept Ans, un tournant
Entre 1756 et 1763, l’Europe bascule dans une guerre inédite par son ampleur. L’Angleterre et la Prusse affrontent la France, l’Autriche et leurs alliés sur quatre continents : en Europe, en Amérique, en Inde et jusqu’en Afrique de l’Ouest. Les alliances se font et se défont, les civils deviennent davantage impliqués – qu’ils combattent, qu’ils soient déplacés ou qu’ils subissent violences et famines.
Cette guerre « classique » par ses batailles rangées annonce déjà les guerres mondiales par sa dimension globale, son bilan humain (près de deux millions de morts) et ses conséquences politiques à long terme, notamment l’affirmation de la puissance britannique outre-Atlantique.

La Bataille de Kunersdorf, 1759
peinture par Alexandre von Kotzebue (musée de l'Ermitage, Saint Petersbourg)
XIXe siècle : la guerre des nations
La Révolution française introduit une rupture majeure : désormais, c’est la nation entière qui prend les armes. La levée en masse de 1792, puis la conscription instaurée en 1798, transforment le soldat en citoyen-soldat. La guerre devient un devoir civique, nourri par un objectif idéologique : défendre la Révolution et propager ses valeurs.
Napoléon mène ainsi des guerres de masse : 650 000 hommes sont engagés dans la campagne de Russie en 1812. L’objectif n’est plus seulement d’imposer une négociation, mais bien de détruire l’armée ennemie. La guerre change d’échelle et s’enracine dans la société.

Austerlitz en Autriche, 2 décembre 1805 : la Grande Armée de Napoléon bat les troupes de l'empereur d'Autriche et du tsar de Russie (peinture de François Gérard)
XXe siècle : l’ère des guerres totales
Avec l’industrialisation, la guerre atteint une intensité inédite. La Première Guerre mondiale inaugure l’âge de la guerre totale : mitrailleuses, artillerie lourde, gaz, chars, mobilisation des usines et des femmes. La Seconde Guerre mondiale pousse encore plus loin cette logique : bombardements massifs, extermination industrielle, armes atomiques.
Les civils deviennent la cible principale : ils représentent 60 % des morts du second conflit mondial. Les idéologies radicales – nazisme, fascisme, communisme – confèrent aux guerres une dimension existentielle : il ne s’agit plus de territoires, mais de survie et d’identité.

Les "munitionnettes" : femmes de tous âges fabriquant des obus, France, 1917
Après 1945 : la dissuasion et la guerre par procuration
L’arme nucléaire instaure un nouvel équilibre : l’affrontement direct entre superpuissances devient impossible. La guerre froide est une guerre sans bataille décisive entre Américains et Soviétiques. Les conflits se déplacent vers la périphérie : Vietnam, Afghanistan, Corne de l’Afrique. Les grandes puissances soutiennent leurs alliés ou leurs guérillas, sans s’affronter directement.

La Guerre civile du Yemen oppose les chiites Houthis soutenus par l'Iran et le gouvernement reconnu du Yemen soutenu par l'Arabie saoudite (sunnite). Photo : Felton Davis/Flickr (CC BY 2.0)
XXIe siècle : guerres asymétriques et terrorisme global
Aujourd’hui, les guerres semblent avoir changé de visage. Les attentats du 11 septembre 2001 ont inauguré une nouvelle ère : celle du terrorisme globalisé, sans frontières, mené par des organisations non étatiques comme Al-Qaida ou Daech.
Ces guerres sont asymétriques : un acteur faible, sans État, frappe un acteur puissant sur ses points vulnérables. Elles sont irrégulières : pas de front, pas de bataille décisive, mais une multitude d’attentats, de guérillas et de combats urbains. Elles sont aussi idéologiques : un djihad transnational s’oppose aux valeurs occidentales, relayé par un djihad médiatique utilisant Internet et les réseaux sociaux.
Face à ce type d’adversaire, les États apparaissent démunis. La disparition territoriale de Daech en 2019 n’a pas mis fin à ses attaques.

Un soldat de Daech en 2015 (image de propagande de l'Etat islamique)
source : akg-images (CC BY-NC 4.0)
Continuités et ruptures
Les guerres contemporaines ne sont pas radicalement étrangères à celles du XVIIIe siècle. Elles conservent une dimension politique – Clausewitz reste d’actualité : la guerre est bien « la poursuite de la politique par d’autres moyens ». Les logiques d’alliance, les enjeux territoriaux ou économiques, l’implication croissante des civils sont des fils rouges qui traversent les siècles.
Mais les ruptures sont profondes : passage de la guerre limitée à la guerre totale, puis à la guerre nucléaire ; implication croissante et massive des sociétés ; émergence d’acteurs transnationaux sans territoire. La guerre n’a pas disparu : elle s’est transformée, élargie, démultipliée.
En définitive, les guerres contemporaines ne sont pas « totalement différentes » de celles du XVIIIe siècle, mais elles en représentent l’aboutissement paradoxal : la mondialisation, l’idéologie et la technologie ont fait exploser les cadres qui limitaient autrefois la violence armée.
Sujets de bac et corrigés
Un sujet classique et très formateur :
Les guerres contemporaines confirment-elles ou remettent-elles en cause la définition de Clausewitz : “la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens” ?

Je ne sais pas avec quelles armes on fera la Troisième Guerre mondiale, mais la Quatrième se fera avec des bâtons et des pierres.
Albert Einstein
(1945)
Résumé audio
Termes à connaître
Brouillard de guerre = expression évoquant l’absence ou l’incertitude des informations de la batailles, aux positions et aux objectifs des belligérants dans une guerre.
Tactique = l’art de mener les combats.
Stratégie = l’art d’agencer les combats en vue de la victoire.
Guerre illimitée = l’objectif est d’annihiler toutes les forces de l’ennemi pour qu’il devienne incapable de renvendiquer quoi que ce soit et qu’il se soumette entièrement à la volonté du vainqueur -> capitulation.
Montée aux extrêmes = chaque camp multiplie sa force cela entraîne un déchainement de violence.
Bataille décisive = engage toutes ses forces pour annihiler la capacité de l’ennemi et le contraindre à capituler -> promet une guerre rapide.
Quiz HGGSP — Faire la guerre, faire la paix
10 questions — choisissez une option par question, puis cliquez sur Soumettre.
sujet de dissertation
Comment la Syrie est passée d’une révolte populaire à un conflit internationalisé ?
A lire
Le livre qui explique pourquoi et comment la guerre de sept ans a marqué le début du déclin de la France et consacré l'Angleterre comme première puissance mondiale de l'époque.
-> disponible en ligne/Amazon