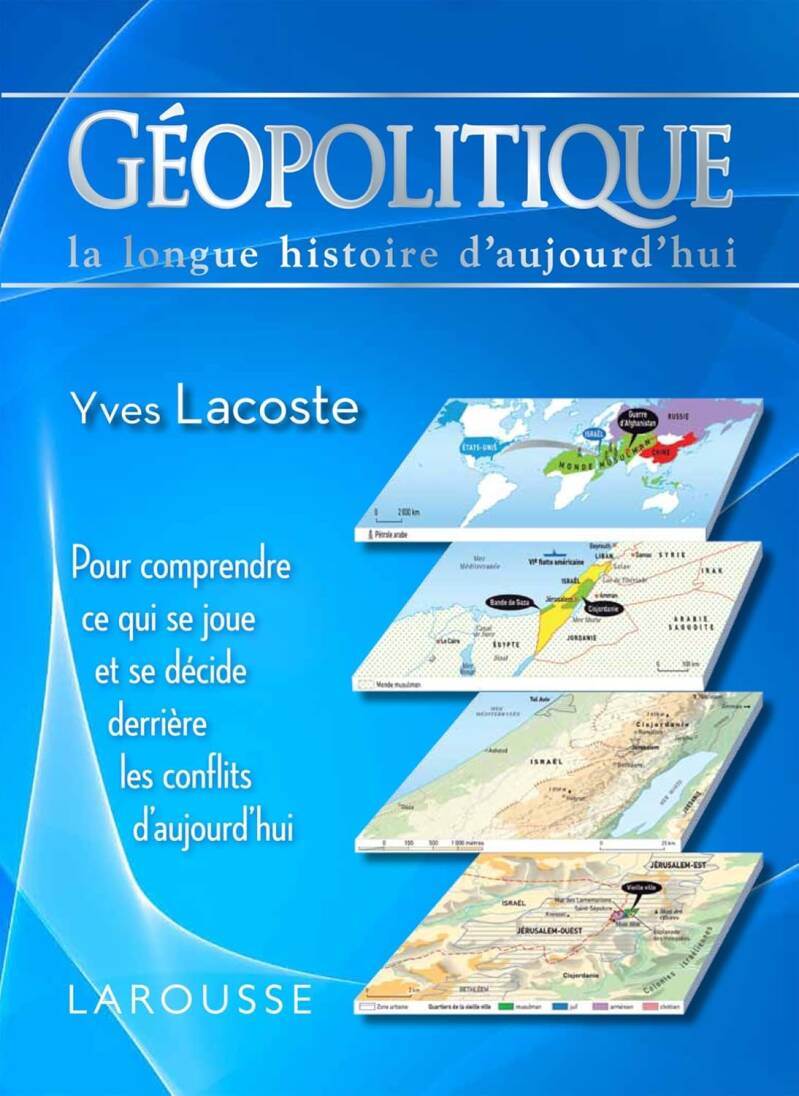Faire la guerre, faire la paix
Du fracas des champs de bataille aux négociations diplomatiques, l’histoire contemporaine illustre à quel point la guerre et la paix sont deux réalités indissociables : comprendre les formes de conflits qui secouent le monde, c’est aussi mieux saisir les chemins, parfois tortueux, qui mènent à la paix.
Pablo Picasso, La Paix, 1952. Huile sur bois, isorel, 4,70 m x 10,20 m, musée national Pablo Picasso,
La Guerre et la Paix. Photo © RMN-GP © Succession Picasso, Paris, 2025.
Depuis que les sociétés humaines existent, elles connaissent des affrontements armés. Mais la guerre n’a jamais pris une seule forme : elle peut opposer des États puissants sur des champs de bataille, comme au temps des guerres napoléoniennes, ou surgir de manière plus diffuse, à travers des groupes terroristes transnationaux comme Al Qaïda ou Daech. L’histoire montre que la guerre n’est pas seulement un déchaînement de violence : elle est profondément politique, comme l’avait formulé le théoricien prussien Clausewitz en la définissant comme « la continuation de la politique par d’autres moyens ».
Étudier la guerre aujourd’hui, c’est donc tenter de comprendre sa diversité : guerres « classiques » entre États, guerres civiles, conflits irréguliers, cyberattaques, terrorismes… Les acteurs ne sont plus seulement les armées régulières et les gouvernements : s’y ajoutent des groupes armés non étatiques, des organisations internationales, et parfois même des entreprises privées.
Mais à côté de la guerre se pose toujours la question de la paix. Faire la paix, ce n’est pas simplement mettre fin à une bataille : c’est inventer des mécanismes de stabilité et de coopération. Les traités de Westphalie, en 1648, ont ainsi posé les bases d’un ordre international fondé sur les États souverains. Plus récemment, l’Organisation des Nations Unies tente d’instaurer une sécurité collective, en multipliant médiations, sanctions, interventions militaires et missions humanitaires. La paix est donc un processus long, fragile, et toujours remis en question.
Aujourd’hui, le monde est traversé par une grande variété de conflits : guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient, rivalités en mer de Chine, affrontements au Sahel… Chacun a ses causes, ses acteurs, ses logiques propres. Comprendre cette diversité, c’est aussi mieux saisir les difficultés – mais aussi les espoirs – de la construction de la paix.
Ce thème propose ainsi une double exploration : d’une part, celle des formes de guerre et de leur évolution ; d’autre part, celle des moyens d’y mettre fin et de bâtir la paix. Les élèves seront amenés à réfléchir à la fois à la permanence et à la transformation des conflits, mais aussi aux défis diplomatiques, politiques et humains que représente la recherche de la paix au XXIe siècle.