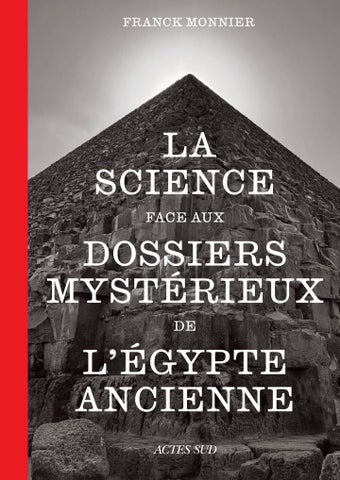À la fois récipients pratiques et supports de croyances religieuses, les vases canopes illustrent le soin minutieux apporté par les Égyptiens à la préservation du corps et de l’âme pour l’au-delà.
Vases canopes égyptiens, vers 664–525 avant JC.
(The Met , New-York)
À quoi servaient les vases canopes ?
Lors du processus de momification, les embaumeurs retiraient les principaux organes internes, jugés susceptibles de provoquer la décomposition du corps : le foie, les poumons, l’estomac et les intestins. Le cœur était souvent replacé dans le corps, considéré comme le siège de l’intelligence et des émotions, tandis que le cerveau était retiré et détruit.
Ces organes vitaux, indispensables pour la survie dans l’au-delà selon la pensée égyptienne, étaient placés dans des vases spéciaux : les vases canopes.
Des contenants devenus symboles religieux
À l’origine, les vases canopes avaient des couvercles simples, souvent ronds. Mais à partir du Nouvel Empire (vers 1550 av. J.-C.), ils se chargèrent d’une iconographie précise : les couvercles prirent la forme de têtes représentant les Quatre Fils d’Horus, divinités protectrices des viscères, chacun associé à une déesse gardienne et à un organe
-
Imsety, à tête humaine, protégeait le foie, avec la déesse Isis.
-
Hâpi, à tête de babouin, protégeait les poumons, avec Nephtys.
-
Douamoutef, à tête de chacal, protégeait l’estomac, avec Neith.
-
Qebehsenouf, à tête de faucon, protégeait les intestins, avec Serqet.
Ces associations reflétaient la conception complexe de l’équilibre cosmique et du rôle de chaque divinité dans la sauvegarde de l’être humain après la mort.
Une évolution au fil des dynasties
Les vases canopes étaient généralement fabriqués en calcaire, albâtre, ou céramique émaillée, parfois en bois peint pour les tombeaux plus modestes.
À partir de la XXIe dynastie (vers 1070 av. J.-C.), une évolution notable apparaît : les organes ne sont plus toujours déposés dans les vases, mais replacés dans le corps momifié après avoir été enveloppés et enduits de résine. Les vases canopes conservent alors leur fonction symbolique et continuent d’accompagner le défunt, même vides.
Des témoins d’un rapport unique à la mort
Les vases canopes que l’on peut admirer aujourd’hui dans les musées du monde entier — du Caire au Louvre en passant par le British Museum et le Met de New-York — témoignent de l’importance capitale du culte funéraire égyptien.
Ils ne sont pas de simples récipients : ils incarnent la volonté de préserver l’intégrité de l’être, de garantir la résurrection et l’accès au monde éternel. Leur iconographie et leur disposition dans les tombes en disent long sur la manière dont les Égyptiens concevaient la relation entre le corps, l’âme et les dieux.
Les vases canopes, en somme, ne sont pas seulement des objets archéologiques fascinants : ils représentent la confiance des anciens Égyptiens dans la possibilité d’une vie après la mort, où chaque fragment du corps avait sa place et sa protection divine.
Selon l'égyptologue James Henry Breasted, " Les jarres canopes, si souvent admirées dans les musées, ne sont que la partie visible d’un vaste ensemble de croyances où la mort n’était qu’un passage, et la conservation du corps, une garantie contre l’oubli. "
Vases canopes égyptiens, vers 1750 JC.
(The Met , New-York)

La momification, loin d’être un rituel mécanique, était un acte spirituel. Les vases canopes, qui recueillaient les viscères, participaient à la sauvegarde de l’intégrité du défunt, condition essentielle pour renaître.
Christiane Desroches Noblecourt

Salut à vous, les quatre génies qui reposent dans l’intérieur de la poitrine du Seigneur d’Occident !
Livre des Morts
(chapitre 151, formule adressée aux vases canopes)