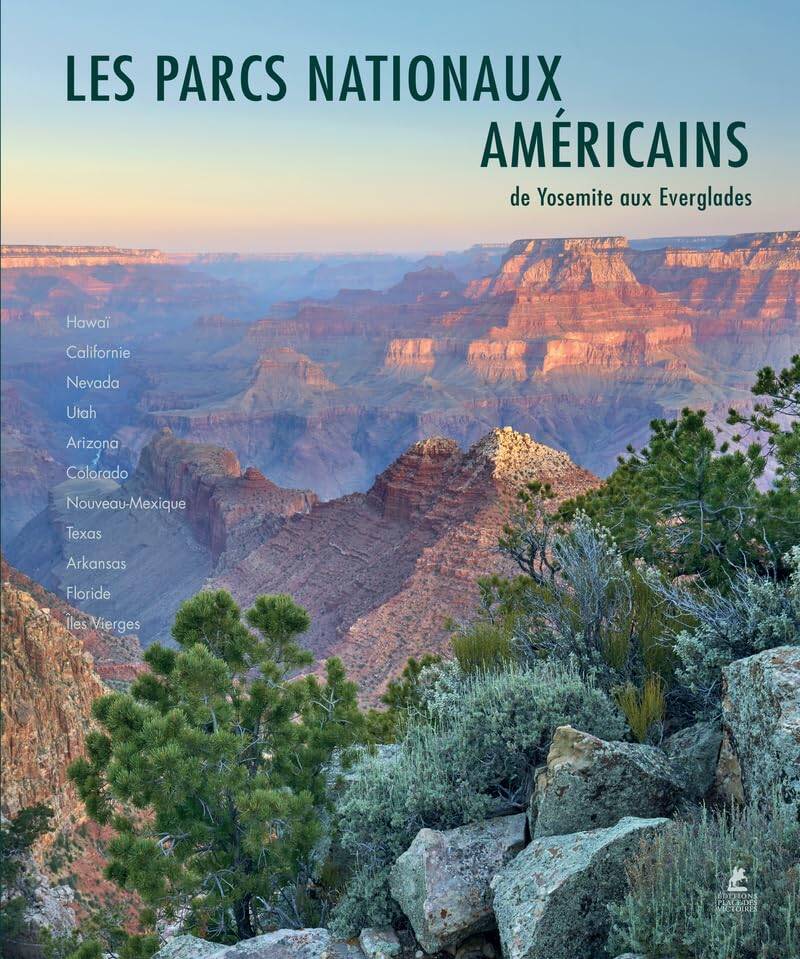Quatre présidents géants sculptés à coups de dynamite et de marteaux-piqueurs… mais avec une précision héritée des sculpteurs grecs de l’Antiquité. Un chef-d’œuvre technique, taillé dans une montagne sacrée des Lakotas, qui raconte l’Amérique autant qu’il divise.
Perché dans les Black Hills du Dakota du Sud, le mont Rushmore aligne quatre visages colossaux de présidents américains : Washington, Jefferson, Roosevelt et Lincoln. Entre 1927 et 1941, plus de 400 ouvriers ont arraché 450 000 tonnes de granit pour les révéler. Le chantier, supervisé par le sculpteur Gutzon Borglum, est souvent présenté comme un triomphe de la technologie moderne. Mais derrière la dynamite et les compresseurs à air, une partie des méthodes employées remonte… à l’Antiquité grecque.
sculpture du mont Rushmore : de gauche à droite Washington, Jefferson, Roosevelt et Lincoln
(Thomas Wolf, CC BY-SA 3.0)
Un projet pharaonique au cœur des montagnes sacrées
Dès le départ, Borglum sait qu’il ne sculptera pas une simple fresque : il veut un symbole national gravé dans la pierre, visible à des kilomètres. Pour cela, il faut d’abord apprivoiser la montagne. Les Black Hills sont composées d’un granit extrêmement dur, résistant à l’érosion — parfait pour durer des siècles, mais impitoyable à travailler.
La dynamite pour dégrossir, l’air comprimé pour affiner
La première étape est brute : de petites charges de dynamite soigneusement calculées arrachent des blocs de granit sans fissurer la roche restante. C’est un travail millimétré : parfois, il faut retirer 15 à 20 centimètres de roche seulement. Une fois les formes générales obtenues, les marteaux-piqueurs pneumatiques prennent le relais, affinant les courbes des nez, la ligne des lèvres, la rondeur des pommettes.
L’héritage discret des Grecs
Mais le plus fascinant est invisible à l’œil nu : le transfert des proportions depuis la maquette jusqu’à la falaise. Borglum utilise un procédé qui aurait parfaitement convenu à un sculpteur d’Athènes au Ve siècle av. J.-C. : le pantographe.
Ce dispositif, déjà connu des artisans grecs pour agrandir ou réduire fidèlement un modèle, fonctionne ici à échelle monumentale. Dans l’atelier, un modèle en plâtre mesurant environ 1/12e de la taille finale sert de référence. À l’aide d’un bras articulé métallique fixé sur un point pivot, on relève chaque repère du visage miniature, puis on le reporte directement sur la roche, multiplié par douze.
Ce système permet non seulement d’obtenir des proportions exactes, mais aussi d’introduire des « corrections optiques », comme le faisaient les sculpteurs grecs : agrandir certaines parties (fronts, yeux) et en réduire d’autres (mentons) pour que le visage paraisse harmonieux vu d’en bas.
Pour que les visages du mont Rushmore paraissent « naturels » vus depuis le sol, Borglum a dû tricher avec les proportions — un peu comme les sculpteurs grecs le faisaient pour les statues colossales.
Les fronts, les yeux et le nez ont été sculptés légèrement plus grands que nature. Cela compense l’angle de vue, faisant que, vu du bas, tout semble harmonieux. De même les bouches et mentons sont un peu moins saillants que dans la réalité. Sans cette correction, on aurait eu un « effet menton géant » depuis le sol.
Les rides, plis de paupières et arêtes nasales sont creusés beaucoup plus profondément que sur un visage humain. Cela permet de conserver le relief même lorsque la lumière est rasante ou que l’on regarde de loin.
Borglum a également pris en compte l'éclairage naturel : le monument est orienté de façon à ce que la lumière du soleil éclaire les visages presque toute la journée. Les reliefs accentués évitent ainsi que les traits disparaissent dans les ombres au mauvais moment
En résumé, les présidents ne sont pas vraiment « anatomiquement corrects », mais ils paraissent l’être grâce à ces illusions optiques savamment calculées.
Les yeux qui suivent le spectateur
Borglum emprunte aussi aux Anciens une autre astuce : sculpter des yeux vivants sans peinture. Plutôt qu’un simple trou pour la pupille, il laisse un petit cylindre de granit intact au centre, entouré d’un creux représentant l’iris. Ce relief capte la lumière et donne l’impression que le regard suit le visiteur, comme sur certaines statues grecques où la pupille était suggérée par un relief plutôt que creusée à plat.

détail d'un œil de la sculpture de Lincoln
Un héritage technique au service d’un monument politique
En fin de compte, la modernité du chantier — dynamite, compresseurs, câbles d’acier — s’appuie sur un savoir-faire vieux de deux millénaires. Comme les Grecs façonnaient leurs colosses de marbre pour résister au temps et à la distance, Borglum adapte son art à la montagne, corrige les illusions d’optique, joue avec la lumière.
Mont Rushmore est ainsi à la fois une prouesse technique de l’ère industrielle et l’héritier discret d’une tradition sculpturale antique. Les outils ont changé, mais l’art de dompter la pierre et l’espace visuel reste le même : séduire l’œil humain, hier comme aujourd’hui.

Dites-moi que vous vous portez bien, et aussi bien que le Pont-Neuf.
Lettres de l'abbé Galiani (1775)

Construction du visage de Georges Washington
(Rise Studio, R1932)
Quatre visages qui n'ont pas été choisis au hasard
En choisissant Washington, Jefferson, Roosevelt et Lincoln, Gutzon Borglum ne cherchait pas à dresser une simple galerie présidentielle, mais à condenser l’épopée américaine en quatre chapitres.
-
Washington, père fondateur, incarne la naissance de la nation et l’indépendance.
-
Jefferson, visionnaire de l’expansion, symbolise l’achat de la Louisiane et l’ouverture de nouvelles terres.
-
Roosevelt, champion du progrès, reflète l’essor industriel et l’affirmation du pays sur la scène mondiale.
-
Lincoln, le président de l’Union, personnifie l’abolition de l’esclavage et la préservation de l’unité.
Avec cette œuvre, Borglum voulait inspirer l’unité et le prestige national dans l’Amérique des années 1930, en pleine Grande Dépression.
Les polémiques autour du mont Rushmore
Symbole patriotique pour beaucoup d’Américains, le mont Rushmore est aussi un lieu de discorde.
-
Un site sacré spolié : creusé dans les Black Hills, montagne sacrée des Lakotas, il viole le traité de Fort Laramie (1868) qui garantissait ces terres aux Sioux. La découverte d’or en 1874 entraîne leur saisie par les États-Unis.
-
Un sculpteur controversé : Gutzon Borglum, avant Rushmore, avait collaboré avec des membres du Ku Klux Klan sur un autre monument. Son nationalisme affiché nourrit les critiques.
-
Une vision exclusive : l’idée initiale prévoyait des figures régionales, y compris des chefs amérindiens. Borglum recentre sur quatre présidents, effaçant la mémoire autochtone.
-
Des revendications toujours vives : en 1980, la Cour suprême reconnaît la spoliation et accorde une compensation financière que les Sioux refusent, affirmant que « la terre n’est pas à vendre ».
Entre prouesse technique et cicatrice historique, le mont Rushmore reste un monument à la fois admiré et contesté — reflet des contradictions de l’histoire américaine.